|
Avant l'édit de mars 1720, les compagnies de maréchaussée, indépendantes les unes des autres, étaient commandées par des officiers créés sous différents titres. Compte tenu des pouvoirs judiciaires que François Ier accorda à ces derniers, il fallut leur adjoindre des magistrats pour s'assurer de la légalité de leurs actes. Ainsi, chaque compagnie était formée d'officiers d'épée qui commandaient les archers et d'officiers de robes spécialement chargés du bon déroulement des procédures judiciaires. Ainsi, sous les ordres du prévôt, commandant la compagnie il y avait :
- Pour la troupe : un ou plusieurs lieutenants, qu'on appelait prévôts particuliers lorsqu'ils commandaient des unités appelées lieutenance, un ou plusieurs exempts pour seconder les lieutenants, les archers en nombre variable en fonction de l'étendue de la généralité et un trompette (attaché à la personne du prévôt).
- pour les officiers de robe : un procureur du Roi de maréchaussée, un assesseur et un greffier dans chacune des lieutenances de la compagnie.
Les prévôts des maréchaux devaient s'employer continuellement à l'exercice de leur office![]() . Il leur était défendu de s'ingérer dans d'autres fonctions que celles qui leur étaient prescrites. Les Ordonnances de Moulins, Blois et Orléans leur imposaient ainsi qu'à leurs lieutenants « de faire leurs chevauchées continuellement par les champs sans séjourner dans les villes sinon par occupations nécessaires et légitimes, afin de purger les provinces de gens mal vivants ».
. Il leur était défendu de s'ingérer dans d'autres fonctions que celles qui leur étaient prescrites. Les Ordonnances de Moulins, Blois et Orléans leur imposaient ainsi qu'à leurs lieutenants « de faire leurs chevauchées continuellement par les champs sans séjourner dans les villes sinon par occupations nécessaires et légitimes, afin de purger les provinces de gens mal vivants ».
Un arrêt du Grand Conseil du 30 juin 1618 porte que « le prévôt des maréchaux, ses lieutenants, greffiers et archers feront leurs chevauchées ordinaires trimestriellement par tout le ressort ». À cette occasion, des procès-verbaux étaient dressés et certifiés par les juges des lieux où ils passaient. Ils pouvaient au cours de leur périple résider plus de vingt-quatre heures en un lieu sans cause légitime. Ils devaient arrêter les criminels pris en flagrant délit ou à la clameur publique. Les vagabonds, gens sans aveu![]() et mendiants valides pour les juger, mais il leur était interdit d’arrêter les domiciliés sans décret si ce n'est dans le cas du flagrant délit ou à la clameur publique sous peine d'être tenu responsable des dommages et intérêts des parties.
et mendiants valides pour les juger, mais il leur était interdit d’arrêter les domiciliés sans décret si ce n'est dans le cas du flagrant délit ou à la clameur publique sous peine d'être tenu responsable des dommages et intérêts des parties.
Pour protéger les prévôts, lieutenants et archers des insultes et des rébellions dans l'exercice de leurs fonctions, la loi avait prévu que ce genre d'affaires serait de la compétence du siège de la connétablie et maréchaussée de France. Cette disposition ne s'appliquait pas dans les cas prévôtaux.
Pour les malfaiteurs qui leur résistaient ou les agressaient dans leur exercice, la loi était extrêmement sévère et les militaires qui prenaient les armes contre les prévôts de maréchaussée et leurs archers encouraient d'être condamnés à mort suivant l'article 53 de l'Ordonnance du 8 avril 1718.
Après leur nomination, le prévôt ou ses lieutenants devaient avant d'occuper le poste, être reçus au siège de la connétablie et maréchaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris. Ces places n'étaient données qu'à des personnes capables et expérimentées en fait d'armes, totalisant au moins quatre ans de service militaire.
Rendus sur les lieux de leur résidence, ils devaient exécuter plusieurs formalités administratives au nombre desquelles l'enregistrement de leurs provisions au greffe de leur compagnie suivant l'Édit de Roussillon. Ils devaient par la suite se présenter au Parlement, ou siège présidial dans le ressort duquel était implantée la compagnie pour y prêter serment et faire enregistrer sans frais, leurs provisions (arrêt du Conseil du 8 janvier 1724).
Ils étaient mis au nombre des officiers royaux suivant l'arrêt du Parlement de Paris du 2 août 1625. L’Ordonnance d'Orléans leur interdisait de posséder plusieurs offices et leur donnait la qualité d'écuyer tant qu'ils étaient revêtus de leurs charges. Suivant l'Édit de mars 1720, leur nomination était faite en titre d'office et ces offices étaient héréditaires. Cette hérédité de charge ayant été à l'origine de nombreux abus sera supprimée en 1760, puis dans une déclaration du 28 février 1768, le Roi disposa que les offices de prévôts et de lieutenants seraient désormais possédés sur commissions![]() par des officiers ayant accompli douze années de service pour les premiers et huit pour les seconds.
par des officiers ayant accompli douze années de service pour les premiers et huit pour les seconds.
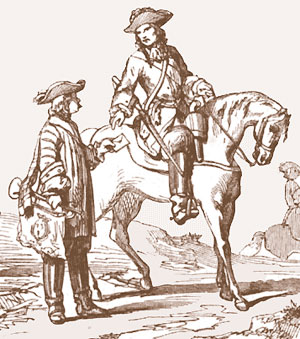
Le Roi ayant reconnu la dangerosité de leurs états leur accorda, comme à tous les personnels militaires et officiers de robe des compagnies, l'exemption de la collecte de logement de gens de guerre, tutelle, curatelle et autres charges publiques ( Édit de mars 1720 ). De plus, ils jouissaient des privilèges accordés aux officiers commensaux de la maison du Roi et du droit de « committimus ». Ce droit était étendu à leurs épouses, enfants et personnels à leur service. Les raisons de ce privilège étaient de les soustraire aux justices ordinaires et officiers des parlements jaloux de leurs pouvoirs en matière de justice.
Les gages et soldes des officiers de maréchaussées n'étaient sujets à aucune saisie si ce n'est pour dettes contractées à l'occasion de l'achat ou de l'entretien de leurs montures, nourritures et équipages auquel cas la moitié de leur solde était retenue. Les gages des prévôts et des lieutenants pouvaient être saisis uniquement pour les dettes contractées à l'occasion de l'acquisition de leurs offices (Déclaration du 28 Mars 1720).
Les motifs de ces privilèges ne reposaient pas seulement sur le rang et la considération dont jouissait cette arme et sur le mérite de ses services, mais ils étaient fondés sur la nécessité de les dédommager de la médiocrité de leurs gages.
Les officiers et archers de ces compagnies pouvaient aussi obtenir des lettres de vétérance. Elles permettaient à celui qui en était pourvu de conserver sa vie durant, les mêmes honneurs, prérogatives, exemptions, franchises et libertés dont il jouissait auparavant. Ces lettres furent d'abord accordées après 20 ans de service, puis après 25 ans.
Si les prévôts ou leurs lieutenants se rendaient coupables d'abus ou de malversation dans l'exercice de leurs charges, et que ces fautes avaient un lien direct avec leurs fonctions, ils étaient justiciables uniquement au siège de la connétablie et maréchaussée de France. Les officiers des présidiaux n'avaient même pas le droit de prendre connaissance de la faute suivant un arrêt du Grand Conseil de 1702. Ils pouvaient interjeter appel de la décision devant le Parlement. Un Arrêt du Grand Conseil de 1724 indiquait qu'en cas de prévarication ou de mauvaise conduite de leur part, les procureurs généraux devaient en informer les secrétaires d’État à la Justice et de la Guerre. Ces derniers en rendaient compte au Roi à qui il appartenait de prendre les sanctions.
Lorsque les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants commettaient des délits en dehors de leurs fonctions, l'instruction relevait du lieutenant criminel du présidial. Il en était de même lorsque les abus commis par les officiers de maréchaussée étaient commis en exécutant les jugements, ordonnances ou mandements des juges ordinaires et autres que ceux de maréchaussée.
Dans leurs origines, les prévôts des Maréchaux avaient la possibilité de nommer aux places de greffiers et d'archers de leurs compagnies et de commettre leurs lieutenants suivant la Déclaration du 20 janvier 1514. Ce pouvoir leur sera très vite retiré par François Ier et confirmé par l'Édit d'Amboise de 1559. Suivant l'Édit de mars 1720, les places de prévôt et de leurs lieutenants étaient créées en titre d'office et héréditaire, tandis que celles d'assesseurs, de procureurs du Roi et de greffiers des maréchaussées étaient exercées sur commission du grand sceau.
Les places d'exempts, brigadiers, sous-brigadiers, archers et trompettes étaient également exercées sur commission du grand sceau. Les prétendants étaient alors présentés par les prévôts généraux qui devaient s'enquérir de leur aptitude physique, de leur valeur et de leur moralité. Les prévôts avaient interdiction, sous peine d'être condamnés à dix ans de prison par les maréchaux de France, d'exiger ou de recevoir de l'impétrant une quelconque rétribution.
Les prévôts devaient adresser au greffe de la connétablie et maréchaussée de France un rôle signé par tous les membres du personnel composant la compagnie suivant l'Édit de Roussillon d'août 1564. Ce rôle comportait les noms et surnoms de leurs lieutenants, exempts, archers et greffiers. Il devait aussi mentionner leurs lieux de résidence pour les rappeler en cas de besoin.
La discipline des personnels de leur compagnie leur incombait entièrement. Ainsi il était du devoir du prévôt de présenter aux juges du présidial les archers qui se seraient rendus coupables de fautes ou abus qu'ils auraient pu commettre pendant leurs fonctions (Édit d'Amboise de Février 1559). Leurs responsabilités étaient aussi engagées lorsque les archers commettaient ces fautes en leur présence et plus encore en leur absence si cette dernière s'avérait illégitime.

Suivant le même édit, les prévôts pouvaient suspendre, casser et même destituer les archers qui refusaient de leur obéir et les faire remplacer. Avec l'ordonnance de mars 1720, le refus d'obéissance des exempts, brigadiers et sous-brigadiers fut jugé sans appel par un Conseil de guerre composé d'officiers attachés aux deux maréchaussées les plus proches. Les jugements rendus pouvant aller de la destitution à la peine corporelle.
Il leur était interdit ainsi qu'à leurs lieutenants et exempts d'employer les archers comme domestique. Ils devaient résider dans le lieu de leur établissement.
Les prévôts étaient tenus de passer en revue trimestriellement tous les personnels des lieutenances et brigades qui relevaient de leur commandement pour s'assurer de la bonne marche des unités et prendre en compte les problèmes d'habillement, d'équipement, d'armement et ceux liés à la qualité des chevaux (elles seront réduites à deux par an en 1760). Elles étaient précédées mensuellement par des revues réalisées par les lieutenants sur les brigades de leurs lieutenances (réduites à six par an en 1760). C'était au cours de ses revues que les personnels recevaient leur solde en présence de l'intendant (ou d'un de ses délégués).
Tous les deux mois, les prévôts adressaient au ministre de la guerre les états des brigades de leur arrondissement sur lesquesl étaient inscrits les tournées journalières et les services auxquels elles avaient été employées.
Les prévôts des maréchaux avaient l'instruction entière des procès prévôtaux. Les lois leur permettaient de subroger à leurs lieutenants et à défaut leur assesseur, l'instruction de ces mêmes procès et choses dépendantes de leurs charges. Ils ne pouvaient commissionner leurs archers, les notaires ou autres personnes, pour instruire les cas prévôtaux à peine de nullité de la procédure et d'interdiction contre le Prévôt (Ordonnance 1670) Ils pouvaient cependant, en cas d'absence ou autre empêchement légitime du greffier de la maréchaussée en commettre un autre pourvu qu'il soit majeur (Déclaration du 9 Avril 1720).
Suivant un autre arrêt du Grand Conseil de 1608, ils devaient réaliser l'instruction et préparer le procès dans les deux mois après que le jugement de compétence leur soit favorable sous peine de tous les dépens, dommages et intérêts des parties, suspension ou privation de leurs charges.
L'instruction devait être réalisée dans la chambre des interrogatoires des prisons et non ailleurs. Ils étaient tenus d'avoir un dépôt public pour les minutes de leur greffe.
Jusqu'en 1720, les lieutenants étaient chargés de suppléer les prévôts. Lors de la mise en place des nouvelles maréchaussées, on leur confia le commandement et le contrôle du service des unités dans une circonscription territoriale : la lieutenance. Dès lors, ils eurent en charge d'assurer la justice prévôtale dans son ressort. En 1778, les places de lieutenants furent réservées pour moitié aux sous-lieutenants du corps et pour moitié aux officiers de troupes.
Les prévôts des maréchaux étaient tenus de mettre à exécution les décrets et mandements de justice lorsqu'ils en étaient requis par les juges royaux et sommés par les procureurs du Roi ou par les parties. En cas de refus, ils s'exposaient à une peine d'interdiction et trois cents livres d'amende dont la moitié était versée à la couronne et l'autre aux parties (Ordonnance d'Orléans, de Moulins, de Blois et de 1670).
La Déclaration du 26 Février 1724, exigea de la part des officiers et archers de maréchaussée que cette exécution soit faite sur le champ et sans délai. Ainsi, dès la première réquisition ou sommation qui leur était faite par les procureurs du Roi ou par les parties, ils devaient se mettre en route. Ils devaient également mettre à exécution les décrets qui émanaient des sièges présidiaux et autres juges pour crimes qu'ils soient commis à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs villes de résidence.
D'une manière générale, ils devaient prêter main-forte à l'exécution des décrets et de toutes les ordonnances de justice à peine de radiation de leurs gages. En cas de refus un procès-verbal était dressé par un juge, un huissier ou sergent et adressé aux procureurs généraux des ressorts intéressés qui en informaient le Roi. Cette assistance pouvait s'étendre aux réquisitions des juges des hauts justiciers et leurs procureurs fiscaux.
Ils devaient exécuter les ordres donnés par les Premiers présidents et Procureurs généraux pour tout ce qui concerne le bien de la Justice et de la police générale. Immédiatement et sans en rendre compte à leurs chefs si leurs actions se limitaient à la ville, avec les ordres dans le cas contraire.
Le processus était identique en cas de flagrant délit, lorsqu'il était nécessaire de prêter main-forte pour l'exécution des mandats de justice ou sur la simple réquisition des huissiers et autres officiers de justice chargés de les mettre à exécution. En cas de refus, ils s'exposaient à des peines d'interdiction et plus encore. Toutefois, les prévôts, lieutenants et archers de maréchaussée n'étaient pas soumis aux ordres des autres officiers de ces cours qui devaient s'adresser aux Premiers présidents ou Procureurs généraux, seuls juges de la suite à donner.
Un arrêt du Grand Conseil du 18 avril 1721 leur enjoignait d'assister ou prêter main-forte aux réquisitions des officiers et sergents des Eaux et Forêts pour l'exécution des jugements, décrets et ordonnances des Grands Maîtres de la Table de Marbre et de ceux résidents aux sièges des maîtrises, grueries et autres juridictions des eaux et forêts. En cas de refus, ils s'exposaient à perdre leurs gages et même à être cassés.
Ils étaient aussi tenus de monter à cheval à la demande des maires et échevins et sur plaintes des habitants lorsque ces derniers leur signalaient des vol, meurtre ou autre délit commis en la province. Ils devaient intervenir sans délai et sans demander aucune contrepartie. En cas de refus, ils s'exposaient à la privation de leurs états et plus encore. (arrêt du Grand Conseil du 30 Juin 1618).
Les prévôts généraux et leur compagnie étaient tenus de rendre les honneurs aux personnages les plus importants de l'État lorsque ces derniers se rendaient dans les provinces. Ainsi :
Un Édit de 1549 prescrivit aux baillis, sénéchaux et les juges présidiaux de passer en revue les compagnies de maréchaussée afin d'établir un état de paiement des soldes des personnels. Ce paiement était alors réalisé par les receveurs généraux et particuliers des provinces. La méconnaissance militaire des personnels chargés de ce contrôle avait créé des abus sans fin.
En mars 1586, le Roi institua les commissaires et contrôleurs aux montres![]() (revues) pour donner à cette opération toute sa rigueur et sa justesse. Outre leur expérience en fait de guerre et leur probité, ces hommes devaient pouvoir établir un état pertinent des personnels, des matériels, de l'armement, des montures et des équipements. Ils devaient aussi, à cette occasion, être capables de régler les différends entre les officiers et archers. A l'issue, les receveurs et payeurs des maréchaussées payaient les personnels. Ces derniers avaient été créés cette même année 1586 et établis dans toutes les juridictions prévôtales.
(revues) pour donner à cette opération toute sa rigueur et sa justesse. Outre leur expérience en fait de guerre et leur probité, ces hommes devaient pouvoir établir un état pertinent des personnels, des matériels, de l'armement, des montures et des équipements. Ils devaient aussi, à cette occasion, être capables de régler les différends entre les officiers et archers. A l'issue, les receveurs et payeurs des maréchaussées payaient les personnels. Ces derniers avaient été créés cette même année 1586 et établis dans toutes les juridictions prévôtales.
En 1721, un arrêt du conseil ordonna que ces revues soient faites par le prévôt général assisté de l'intendant tous les trois mois. En 1729, elles se tinrent tous les quatre mois sous l'autorité des commissaires des guerres.
Suivant l'Édit de mars 1720(1), les offices des prévôts des maréchaux étaient vendus 40 000 livres. Les gages des prévôts étaient fixés annuellement à 1 200 livres et leur solde à 2 100 livres payée trimestriellement.
Les offices des lieutenants étaient vendus 15 000 livres. Leurs gages se montaient à 450 livres et leur solde à 1 050 livres par an payée trimestriellement.
Les gages représentant l'intérêt à 3% du montant de leur charge.
Les gages et soldes des officiers de maréchaussées ne pouvaient sujets à aucune saisie si ce n'est pour dettes contractées à l'occasion de l'achat ou de l'entretien de leurs montures, nourritures et équipages auquel cas la moitié de leur solde était retenue. Selon la déclaration du 28 mars 1720 (2), les gages des prévôts et des lieutenants pouvaient être saisis uniquement pour les dettes qu'ils auraient pu contracter à l'occasion de l'acquisition de leurs offices
L'ordonnance du 28 avril 1778(3) attribuera aux prévôts généraux le rang de lieutenant-colonel et aux lieutenants celui de capitaine.
(1) Édit de mars 1720 portant suppression de tous les officiers et archers des maréchaussées et établissement de nouvelles compagnies de maréchaussées dans toute l'étendue du royaume.
(2) Déclaration du 28 Mars 1720 portant réglement pourles nouvelles compagnies demaréchaussées.
(3) Ordonnance du 28 avril 1778 concernant la maréchaussée.
Dans une ordonnance du 11 août 1578, Henri III décidait que l'effectif de chaque unité militaire serait augmenté de quatre archers qu'il dispensa de port de hoquetons et hallebardes pour ne pas les confondre avec les anciennes milices connues sous le nom de franc-archer. Ces soldats exempts du port de l'uniforme furent tout simplement appelés « exempt ». Le terme demeura et très vite le ministère de la guerre l'adopta pour exprimer un grade qui fut introduit peu à peu dans tous les corps militaires.
Le premier exempt de la maréchaussée fut créé par Henri IV en 1603. Il fut établi en la compagnie du prévôt de l'Île de France. Ce monarque en créa un second en la compagnie du prévôt général de Normandie en 1606. Il faut attendre l'édit de février 1612 (1), donné à Paris par son fils Louis XIII afin que cette charge, établie sous le nom et titre d'exempt de la maréchaussée, soit créée en titre d'office en chacune des compagnies de maréchaussée. Pour remplir ces places, la charge et qualité d'exempt fut dans un premier temps attribuée à l'archer le plus ancien. Si ce dernier refusait cette charge ou n'était pas en mesure de l'acheter, elle revenait à un autre archer de la compagnie. Cette création avait été demandée par les connétable et maréchaux de France car " le royaume étant inondé d'un grand nombre de voleurs et autres malveillans, tellement que pour les réprimer et tenir la campagne libre et assurée, les prévosts et leurs lieutenants sont forcés d'être continuellement à cheval et éloignés de leur troupe et que faute de personnes ayant qualité pour commander en leur absence, il en résulte une grande confusion et souvent des retards dans l'exécution des ordres."
Jusqu'à la création de cette charge et en l'absence d'officier pour les commander, le commandement revenait de droit à l'archer le plus ancien, mais cette désignation était le plus souvent une source de conflits entre archers au détriment du service à accomplir, le plus ancien n'étant pas forcement le plus capable.
Avec cet édit, seules, les compagnies ayant plus de dix archers pouvaient bénéficier de cette mesure. Le titre d'exempt permettait à celui qui le détenait de commander les autres archers sans que son autorité soit remise en cause par les autres archers. Il avait le droit de les mener et conduire et d'informer sur les crimes. Si l'archer revêtu de ce titre avait la prééminence sur les autres archers, recevait les honneurs due à son autorité, il conservait malgré tout ses gages d'archer.
La responsabilité dont furent investis les exempts ne fut vraiment reconnue qu'avec l'édit d'octobre 1631 portant création de cinquante offices d'exempts et trois cents archers. À compter de cette date, les exempts de maréchaussée occuperont le troisième rang dans une compagnie. Il commanderont à tous les archers. Leurs gages seront supérieurs à ceux des archers (200 livres pour l'exempt, 100 livres pour l'archer), ils seront pourvus du bâton de commandement, auront le droit de survivance de leurs offices. Ils n'étaient plus tenus de monter à cheval.
Les places d'exempts furent remplies,suivant l'édit de mars 1720, en vertu des commissions du Roi, scellées du grand sceau. Les postulants étaient reçus sans frais par le prévôt général qui devait s'assurer de leur capacité à tenir l'emploi et de leur moralité avant de les proposer.
Leur solde était de 700 livres suivant l'ordonnance du 16 Mars 1710. Considérant que les appointements et soldes n'étaient destinés qu'aux dépenses de leur nourriture et à l'entretien de leur monture et équipement, le roi pouvait en faire saisir jusqu'à la moitié pour régler les dettes contractées à ce sujet. Dans tous les autres cas, les créanciers devaient les poursuivre en justice (Ordonnance du 28 avril 1778).
Ce n'est qu'à partir de 1708 que les exempts de maréchaussée ont pu instruire une affaire uniquement en flagrant délit et au cours d'une arrestation seulement à condition que cette opération soit réalisée en présence du greffier de la maréchaussée. Comme tous les autres officiers et archers de maréchaussées, ils ne pouvaient conserver les meubles, armes ou chevaux saisis ou appartenant aux accusés, ni s'en rendre adjudicataires sous leur nom ou celui d'autres personnes. Dans le cas contraire, ils s'exposaient à la privation de leurs offices, à 500 livres d'amende et à la restitution au quadruple. Ils devaient déposer au greffe les effets appartenant aux accusés absents. Il leur était interdit de les conserver chez eux sous quelque prétexte que ce soit sous peine d'être interdit et de restitution au double de sa valeur.
Comme les brigadiers et sous-brigadiers, les exempts tenaient un journal sur lequel ils inscrivaient les courses ordinaires et extraordinaires auxquelles eux et leurs cavaliers avaient été appelés pour le service. Ce journal était remis tous les mois au lieutenant qui le transmettait au prévôt.
Le grade d'exempt fut supprimé par l'ordonnance du 28 avril 1778 (2) et remplacé par celui de sous-lieutenant.

Le nom d'archer avait été conservé et s'employait pour désigner les gardes chargés de veiller au maintien de la tranquillité publique. Cette notion de protection remontait aux temps où, sur les champs de bataille, les unités d'archers avaient été constituées pour semer le désordre et la panique dans les rangs ennemis et protéger ainsi les compagnies de gendarmerie avant qu'elles n'affrontent dans un terrible corps à corps l'ennemi.
Une fois nommés, les archers devaient se présenter au prévôt général pour prêter serment. La prestation de serment et les provisions de l'archer étaient alors enregistrées par le greffier pour un montant de 2 livres. L'Ordonnance de Blois et les édits de 1629, 1720 et 1753, faisaient interdiction au prévôt général de ne percevoir aucun droit pour la nomination ou la mutation d'un archer sous peine d'être puni de dix ans de prison.
Pour leur éviter d'être mis dans des positions d'infortune, les lois protégeaient les archers contre de nombreux abus. Ainsi, ils ne pouvaient pas être les domestiques du prévôt général ni d'aucun autre officier de maréchaussée. Ils ne pouvaient pas non plus exercer des fonctions d'huissiers, ce travail ayant été déclaré incompatible avec leurs fonctions.
En cas de blessure en service et si leur état ne leur permettait pas de continuer à exercer leurs fonctions, ils étaient admis à l'hôtel royal des Invalides attendu qu'une retenue de trois deniers par livre était effectuée sur leurs gages et leur solde pour l'entretien de cet hôtel.
Cette protection avait, pour contrepartie, de nombreux devoirs, dont celui de l'obéissance sans faille au prévôt. Cette obligation avait fait l'objet de nombreux édits et celui de février 1599, prévoyait qu'en cas de désobéissance, les droits de l'archer étaient suspendus et qu'il pouvait même être destitué en cas de faute grave. L'archer pouvait, cependant, faire appel de sa destitution devant la juridiction de la connétablie et maréchaussée de France.
Comme pour les exempts, le roi pouvait ordonner des retenues sur solde dans le cas seulement ou les dettes avaient été contractées pour l'achat de leur nourriture et à l'entretien de leur monture et équipement. Dans tous les autres cas, les créanciers devaient les poursuivre en justice.
Le service était continuel et pour pouvoir s'absenter de leur résidence, les archers devaient obtenir une autorisation écrite du prévôt sous peine d'être punis comme déserteurs. Ils étaient tenus, pour se marier, d'avoir la permission écrite du prévôt sous peine de destitution.
Leur quotidien était fait de patrouilles et de surveillances. Ils étaient tenus d'assister aux foires et marchés pour veiller à la tranquillité publique. Lors du passage d'une troupe, les brigades situées sur la route devaient l'escorter pour contenir les soldats qui auraient pu s'en écarter. Ils étaient aussi chargés de délivrer des assignations aux témoins, de signifier tout acte aux parties concernées. Ils ne pouvaient recevoir aucune plainte ni être commissionnés par le prévôt pour instruire une affaire. L'ordonnance du 16 mars 1720 (3) ordonna aux archers d'avoir leurs chevaux dans une même écurie afin d'être prêts à partir à la première réquisition.
Sur ordre du prévôt, ils devaient arrêter et écrouer les personnes désignées. Ils étaient tenus de les conduire dans les prisons sans pouvoir les retenir dans des maisons particulières sinon pour permettre au prisonnier de se reposer au cours du trajet ou pour éviter l'évasion du prisonnier en cas d'agression par une bande armée. Hormis ces deux cas, les cavaliers s'exposaient à une peine d'interdiction, de 1000 livres d'amende et des dommages et intérêts aux parties. Si la personne arrêtée se trouvait en possession de quelques effets, ils devaient en dresser inventaire et les remettre sur-le-champ au greffe de la maréchaussée du lieu de la capture ou au plus tard dans les trois jours.
Il leur était interdit de prendre possession des meubles ou effets appartenant aux accusés ni s'en rendre adjudicataires en leur nom ou autrement sous peine de privation de leurs offices, de 500 livres d'amende et de leur restitution au quadruple (Arrêt du Parlement de Paris du 23 février 1606).
Une fois écroués, les archers devaient laisser aux prisonniers qu'ils avaient arrêtés, une copie du procès-verbal de capture et de l'écrou sous peine d'interdiction, de dommages et intérêts versés aux parties et de 300 livres d'amende. Comme les exempts, ils pouvaient en cas de flagrant délit seulement, arrêter les criminels et même entrer dans les maisons des particuliers pour y pratiquer des recherches et des perquisitions.
Afin que « nos sujets ne puissent manquer de secours dans les occasions où le ministère desdites compagnies leur sera nécessaire », le roi répartit les effectifs des compagnies sur toute l'étendue de la province en petites unités : les brigades. Le commandement de ces formations fut confié aux archers les plus aptes et les plus anciens à qui on donna le grade de sous-brigadier ou de brigadier. En dehors de leurs commandements, ils avaient les mêmes attributions que les archers. Les grades de brigadier et de sous-brigadiers avaient été précédés par celui de premier archer par l'édit de février 1640(4).
Le titre d'archer fut définitivement remplacé par celui de cavalier suivant l'article 9 de l'ordonnance du 28 avril 1778. Celui de cavalier sera remplacé par celui de gendarme à la révolution.
Suivant la même ordonnance, le grade de sous-brigadier fut supprimé et le grade de maréchal des logis créé. Les brigades, à l'effectif de quatre, étaient sous le commandement d'un brigadier, celle à l'effectif de cinq sous le commandement d'un maréchal des logis.
En 1720, la solde des brigadiers s'élevait à 600 livres par an soit 50 livres mensuels; celle des sous-brigadiers à 450 livres, soit 37 livres et 10 sous mensuels; celle des archers à 366 livres, soit 30 livres et 10 sous mensuels et les trompettes 270 livres soit 22 livres et 10 sous par mois. Pour leur habillement, armement et équipement, les trésoriers généraux retenaient trimestriellement sur leurs soldes 15 livres aux brigadiers, 12 livres aux sous-brigadiers et 10 livres aux archers. Le produit de ces retenues formera ce que l'on appellera : les masses.
Pour cette époque voici le prix de quelques denrées et services :
En 1778, les tarifs de solde annuel furent établis comme suit : Maréchal des logis : 745 livres ; brigadier : 582 livres ; cavalier : 486 livres ; trompette : 380 livres.
(1) l'édit de février 1612 création d'un exempt en chacune des compagnies des prévôts des généraux, provinciaux, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte.
(2) Ordonnance du 28 avril 1778 concernant la maréchaussée.
(3) Ordonnance du 16 mars 1720 concernant la subordination et la discipline des maréchaussées.
(4) édit de février 1640 création d'un premier archer dans chaque maréchaussée.
Le Roi ne pouvant plaider en personne pour défendre ses intérêts ni ceux de ses sujets délégua ce pouvoir à un officier principal qui porte le titre de procureur général. Ce magistrat fut chargé de veiller à l'application précise et respectueuse des règlements et ordonnances. L'établissement des procureurs est fort ancien. Leur nom vient du pouvoir qu'il exerce au nom d'autrui et qui est fondé sur la procuration dont il sont investis.
Les procureurs généraux étant attachés aux cours supérieures, il fut établi des procureurs du Roi qui leur étaient subordonnés dans les justices royales de bailliage ou sénéchaussée. Leur établissement remonte au XIIIe siècle comme le prouvent les registres du Parlement de Paris. Dès leur prise de fonction, ils faisaient le serment de conserver à tous, quelles que fussent leurs conditions, les droits du Roi. Cependant, ces derniers qui devaient assister à toutes les expéditions de justice et traiter les affaires instruites par les prévôts ou leurs lieutenants négligèrent leurs tâches. Des plaintes s'étant élevées envers ces magistrats, Henri III créa, par un édit de mai 1581(1), un office de procureur du roi en chaque juridiction de prévôts des Maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux pour défendre les intérêts de la couronne, mais ces offices, étant une charge financière trop importante pour la couronne, furent supprimés dès le mois d'août suivant. À leur place, le roi chargea les procureurs de roi des sièges présidiaux de remplir cette fonction avec pouvoir de se faire remplacer par une « personne de probité & qualité requise pour assister aux chevauchées » des prévôts ou de leurs lieutenants. Les postulants devaient être officiers de robe longue et diplômés en droit.
Les procureurs du Roi des maréchaussées exerçaient dans les procès prévôtaux les mêmes fonctions que celles exerçaient par les procureurs du Roi des présidiaux, des bailliages et autres justices royales dans les procès criminels de leur siège. Après les avoir supprimés dans son ordonnance de mars 1720, les procureurs du Roi nommés à ces emplois par Louis XV, le seront uniquement sur commissions scellées du grand sceau (Édit de mars 1720 art 5).

Ces officiers étaient tenus de veiller à l'observation des édits et ordonnances du royaume. Ils avaient en charge d'adresser chaque nouvelle loi aux sièges de leur ressort pour qu'elle y soit lue et publiée. L'article 5 de l'Ordonnance de Moulins leur faisait obligation d'établir annuellement un état des ordonnances mal observées, qu'ils devaient adresser aux procureurs généraux des Parlements avec le détail des causes de cette négligence afin qu'il y soit porté remède. Ils devaient aussi veiller, suivant les Ordonnances de Moulins et de Blois, à la conservation du domaine, des droits du Roi et s'opposer à toutes levées de taxes ou d'impôts non autorisés par des édits ou ordonnances royales. C'était aussi les procureurs du Roi qui, suivant l'Ordonnance d'Orléans, devaient s'informer sur la vie et la moralité des personnes qui se présentaient pour occuper un poste d'officier de la Couronne en recevant les témoins nécessaires à cet effet.
Sur la base des informations qui leur étaient remises par les greffiers, l'article 19 du titre 25 de l'Ordonnance criminelle d'août 1670 enjoignait au procureur du Roi de poursuivre sans délai ceux qui étaient prévenus de crimes capitaux ou qui méritaient d'être punis d'une peine afflictive. Ces poursuites devaient être effectuées même si un arrangement était intervenu entre les parties. Dans le cas contraire, et lorsque le crime était de nature à mériter une peine afflictive, le procureur du Roi devait intervenir et se joindre à la partie civile. À l'issue de l'instruction, il avait trois jours pour rendre ses conclusions qu'il devait remettre au greffier de la maréchaussée ou à leurs commis. Cela étant fait, il ne pouvait assister aux jugements prévôtaux. Si ses réquisitions n'étaient pas suivies et que le cas soit jugé non prévôtal, il devait, ainsi que le greffier des présidiaux, informer le procureur général de la mise en place de la commission chargée d'examiner la demande en cassation des jugements de compétence aussitôt ces jugements rendus (Règlement du 28 juin 1738).
Dans leur quotidien, les procureurs du Roi des maréchaussées devaient assister les prévôts et leurs lieutenants dans les chevauchées qu'ils étaient tenus de faire pour requérir. Ils signaient conjointement avec le prévôt ou son lieutenant, les procès-verbaux qu'ils devaient envoyer tous les six mois au Chancelier et aux procureurs généraux des Parlements (Édit d'avril 1581). En cas d'absence, de maladie ou autres empêchements les procureurs du Roi de la maréchaussée pouvaient se faire remplacer par les procureurs du Roi des sénéchaussées et des sièges présidiaux (Édit de Mai 1581 et Arrêt des Grands jours de Poitiers du 15 Janvier 1689 art 38).
Suivant la déclaration donnée à Versailles le 22 février 1739, les procureurs du Roi des maréchaussées étaient, comme tous les officiers qui composaient la compagnie, reçus en la connétablie et maréchaussée de France pour y prêter serment.
Ils jouissaient de l'exemption de la collecte, logement de gens de guerre, tutelle, curatelle et autres charges publiques, cependant il n'avaient pas le privilège d'être commensaux de la Maison du Roi (Édit de Mars 1720 et Lettres Patentes du 20 Mars 1730).
Les appointements de ces officiers s'élevaient à 300 livres suivant l'Ordonnance du 16 Mars 1720.
Pour les éclairer dans leurs décisions, les Romains avaient autorisé les magistrats à se faire assister d'un conseil. Les personnes qui le composaient n'avaient pas de fonctions permanentes. Pour la ville de Rome, la loi disposait que ce conseil serait formé de dix personnes dont cinq dans l'ordre des sénateurs et cinq dans l'ordre des chevaliers. Dans les provinces, ces magistrats appelés Prœsides pouvaient, dans des affaires graves, se faire assister d'un conseil constitué de vingt personnes. Cependant la loi ne les autorisait qu'à donner leur avis.
Lorsque nos rois installèrent les baillis et sénéchaux, ils conservèrent le même principe. Dans les affaires mineures, ces officiers rendaient seuls la justice. Dans les affaires plus importantes, ils étaient obligés de se faire assister par un conseil choisi parmi les nobles ou les roturiers suivant la qualité du défendeur. Ce conseil, qui n'avait aucun pouvoir, était dissous dès que l'affaire avait été jugée. Cet ordre judiciaire dura jusqu'en 1325, où las des abus qui s'étaient fait jour dans la juridiction du Châtelet, Charles-le-Bel chargea dès le mois de mai deux de ses conseillers à travailler conjointement avec le prévôt pour réformer cette situation. Ces commissaires proposèrent de remplacer les clercs et laïcs qui composaient cette assistance, par huit conseillers, quatre clercs et quatre laïcs qui seraient institués en titre d'office par le chancelier. C'est ce que fit Philippe de Valois en 1327, alors régent de France, qui donna à ces huit assesseurs une séance permanente et le caractère de magistrat.
Ce conseil fut depuis créé dans d'autres sièges comme l'atteste différents édits et dans plusieurs bailliages du royaume, mais son établissement ne fut pas universel. Cette situation fut progressivement réglée à la création des présidiaux par l'édit de janvier 1551. Ces officiers établis en nombre suffisant devinrent les assesseurs ordinaires des baillis et des sénéchaux. Pour les sièges d'un ordre inférieur où il n'avait pas été à propos d'établir un siège présidial, les conseillers furent établis suivant l'édit d'octobre 1571.

Les assesseurs du latin «assidere» qui veut dire «être assis auprès» assistaient et apportaient conseil aux juges subalternes. Ils pouvaient, en cas d'absence ou empêchement légitime du juge, le remplacer. Ces officiers de robe longue devaient nécessairement être diplômés en droit. Ils furent établis dans tous les sièges royaux et présidiaux du royaume par un édit de Henri III donné à Saint Maur au mois de juin 1586. Ils étaient alors désignés sous le titre de lieutenants particuliers, assesseurs criminels et premiers conseillers. L'édit leur attribuait les mêmes compétences que celle du lieutenant général criminel, s'il venait à être absent. Les pouvoirs, dont ils étaient investis, étaient si importants qu'ils prenaient rang juste derrière le lieutenant général criminel et devant tous les conseillers du siège. Ils avaient voix délibérative en audience et au conseil.
Ces offices furent supprimés deux ans plus tard par une déclaration donnée à Chartres le 3 mai 1588, mais ils furent rétablis par un édit d'Henri IV du mois de juin 1596 dans les mêmes termes que l'édit de leur création.
Les prévôts des maréchaux étant des officiers militaires non ou peu instruits aux matières judiciaires, il fut décidé de commettre auprès de leur personne un magistrat assesseur pour leur apporter tout le secours d'un homme de loi, afin de veiller à la régularité de la procédure et vérifier sa conformité vis-à-vis des diverses lois. Cela leur fut ainsi imposé par un arrêt du conseil privé de Charles IX de 1563 qui ordonnait expressément aux prévôts d'appeler pour l'instruction des procès, un des officiers royaux du tribunal le plus proche, ou un conseiller du siège présidial du lieu ou, à défaut, un ancien avocat. Cette procédure, n'étant pas des plus aisée, Henri IV prit soin d'ériger en chacune des juridictions des prévôts des maréchaux un conseiller assesseur par un édit du mois de décembre 1594 (2). Ils furent établis près des prévôts, mais aussi dans les lieux où résidaient leurs lieutenants. Cet édit leur ordonnait de prêter serment devant les sièges présidiaux dans le ressort desquels ils étaient établis. Ils pouvaient informer et décréter en l'absence des prévôts ou des lieutenants des maréchaux. Lors des jugements ils avaient la même séance et voix délibérative que les conseillers des présidiaux.
Louis XV, par son édit du mois de mars 1720 supprima les assesseurs des anciennes maréchaussées de France et en créa de nouveau pour la nouvelle maréchaussée. Ils exerçaient leur charge sur commissions du roi scellées du grand sceau. Une déclaration du 9 avril 1720, enregistrée au parlement de Toulouse le 17 août 1722, ordonnait aux nouveaux assesseurs des maréchaussées d'être reçus et de prêter serment en la connétablie au siège général de la table de marbre du palais à Paris à moins qu'ils ne fussent officiers des bailliages, sénéchaussées et maréchaussées.
La même loi déclarait les commissions d'assesseurs, compatibles avec les offices des bailliages sénéchaussées. Cette déclaration fut confirmée par celle du 22 février 1739.
Leur responsabilité se limitait à leur mission de conseil. Ainsi dans l'exercice courant de leurs attributions, ils devaient assister les prévôts ou leurs lieutenants dans l'instruction des procès prévôtaux.
Les interrogatoires étaient conduits par le prévôt ou son lieutenant et non par l'assesseur qui ne pouvait intervenir qu'en cas d'oubli de la part de ces officiers. Seul le prévôt ou son lieutenant dictait aux greffiers les informations à enregistrer. En cas de désaccord avec l'assesseur, c'étaient leurs paroles qui prévalaient.
Les procès verbaux étaient intitulés au nom du prévôt seul et comportaient une mention selon laquelle l'assesseur était présent. Ils étaient signés conjointement.
En cas d'absence, de maladie ou autre empêchement, les prévôts étaient tenus de se faire assister par un autre officier de robe longue nommé par le président du siège dans lequel se déroulait l'instruction. S'il faisait l'objet d'une récusation, celle-ci était jugée au vu d'un rapport établi par un officier du siège dans lequel devait se dérouler le procès.
Suivant l'article 13 de la déclaration du 28 mars 1720, ils étaient dans l'obligation, sous peine d'être destitués, de se transporter dans les lieux où le prévôt ou ses lieutenants menaient l'instruction. Pour ne pas freiner le cours de la justice, ils pouvaient, en cas d’absence du prévôt ou ses lieutenants informer et décréter, mais ne pouvaient assister au procès qu'ils avaient instruit. Ils n'avaient pas non plus la possibilité d'assister au jugement de compétence.
Lors des assemblées publiques et aux processions, ils marchaient avec le corps du présidial ou avec les juges des lieux de leur résidence.
Les assesseurs des maréchaussées jouissaient de l'exemption des tailles, subsides et autres impositions ainsi que tous les autres officiers de ces tribunaux. Ces privilèges qui leur avaient été accordés par des édits d'Henri IV des années 1595 et 1606 leur ont été confirmés par la suite.
Les greffiers sont des officiers dont les fonctions sont d'écrire les arrêts, sentences, jugements et autres actes qui sont prononcés ou dictés par les juges. Il sont les dépositaires des minutes qui doivent être conservées et en délivrent des expéditions à qui il appartient. Le mot de greffier vient du grec qui signifie « j'écris ». Leur origine reste lointaine. On retrouve dans un règlement du 9 avril 1361 du roi Jean trois greffiers entrant dans la composition du Parlement. Ils étaient alors nommés « registratores seu grefferii ». Les greffiers des maréchaussées avaient les mêmes attributions que ceux qui exerçaient dans les sénéchaussées ou sièges présidiaux. Ils avaient un travail d'écriture qui se répartissait en plusieurs domaines et un travail de conservation des actes de procédures prévôtales. Ils furent créés en titre d'office par Henri II suivant l'article 13 de l'édit de février 1549 (3) . Jusqu'alors, un archer choisit par le prévôt, exerçait la fonction.
Les greffiers des maréchaussées tenaient un registre sur lequel ils inscrivaient les plaintes et les minutes relatives aux jugements prévôtaux rendus dans les présidiaux. Ces minutes étaient au nombre de deux. L'une était détenue par le greffier du siège du présidial, tandis que l'autre était conservée par le greffier de la maréchaussée. Elles devaient contenir, suivant l’ordonnance criminelle, tous les sentences et actes de récolement ![]() et confrontation. Elles pouvaient également faire l'objet des jugements prévôtaux rendus pour les cas de duel.
et confrontation. Elles pouvaient également faire l'objet des jugements prévôtaux rendus pour les cas de duel.
Ces actes devaient être signés par tous les juges ayant assisté aux audiences. Leurs enregistrements et réceptions ne faisant l’objet d'aucune rétribution de la part du greffier. Si au cours du procès, l'accusé était soumis à la question, c'est au greffier de la maréchaussée que revenait la charge de rédiger le procès-verbal et non à celui du siège qui à rendu le jugement.
Dans ses rapports avec le procureur du roi de la maréchaussée, il lui était enjoint de lui transmettre dans les plus brefs délais les grosses et les copies des informations, interrogatoires et tout acte de procédure. Il devait aussi lui faire parvenir toutes les pièces qu'il pouvait demander afin qu'il puisse rendre ses conclusions ou pour qu'il soit procédé le plus rapidement possible à l'instruction et au jugement de l'affaire.
Ils devaient tenir à jour et d'une manière très fidèle les registres relatifs aux jugements et à l'envoi des pièces. Toutes les expéditions de justices ou tous les actes délivrés par les prévôts ou leurs lieutenants ne pouvaient être mis à exécution par les archers, s'ils n'étaient revêtus de la signature du greffier.

Ils étaient tenus comme les greffiers des présidiaux ou sénéchaussées, de faire contrôler tous les six mois leursregistres par les procureurs généraux de leur ressort en leur adressant un extrait signé et visé par le lieutenant criminel et le procureur du Roi. Ils devaient joindre à ces extraits la copie intégrale des jugements de compétences rendus le semestre précédent ainsi que la conclusion de ces jugements suivant les formes prescrites par la déclaration du 5 février 1731.
Ces expéditions étaient accompagnées par un extrait des grâces et abolition même sous forme de lettre prononcée par leurs sièges avec les procédures et sentences d'entérinement suivant l'ordonnance criminelle de 1670.
D'autre part ils devaient adresser annuellement aux receveurs du domaine du Roi, un rôle signé des prévôts, lieutenants, assesseurs et procureurs du Roi contenant la certification des amendes, confiscations et états des meubles saisis sur les prisonniers afin que le receveur puisse en reverser les bénéfices à la couronne.
Ces registres devaient également être présentés lors des revues trimestrielles réalisées par le prévôt général.
Lorsqu'un nouveau personnel était nommé par le Roi, il percevaient le montant de l'enregistrement des provisions, des actes de réceptions et de commissions était fixé suivant la déclaration du 28 mars 1710 à 6 livres pour le prévôt, 4 livres pour les lieutenants, assesseurs, procureurs du Roi des maréchaussées et exempts, 2 livres pour les brigadiers, sous-brigadiers et archers.
Tous les trimestres, ils devaient accompagner le prévôt ou les autres officiers dans leurs chevauchées et signer le procès-verbal de leur tournée. Ils étaient soumis aux ordres du prévôt auquel ils devaient respect et obéissance en tout ce qui leur commandait.
Comme pour les autres officiers, les places de greffiers ne sont plus pourvues en titre d'office, mais exercées sur des commissions du Roi scellées du grand Sceau suivant l'édit de mars 1720.
Ils sont reçus, comme les procureurs du roi des maréchaussées et les assesseurs, en la connétablie et maréchaussée de France afin d'y prêter serment suivant la Déclaration donnée à Versailles le 22 février 1739.
Ils ne peuvent se dire officiers royaux sous peine d'être destitués de leurs places (Déclaration du 5 février 1549). Leurs appointements sont de 350 livres suivant l'ordonnance du 16 mars 1720.
(1) Édit de mai 1581 portant création d'un procureur du roi en chacune juridiction des prévôts des maréchaux, lieutenants criminels de robe courte, vice-baillis et vice-sénéchaux.
(2) édit du mois de décembre 1594 création d'un conseiller de sa majesté, assesseur en chacune juridiction des prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants de robe courte.
(3) Déclaration du 5 février 1549 portant pouvoir aux Prévosts & Juges Présidiaux de juger par prévention & concurrence & sans appel les Voleurs de grands Chemins, Sacrilèges & Faux Monnoyeurs & établissement de Greffiers à la suite des Prévosts.